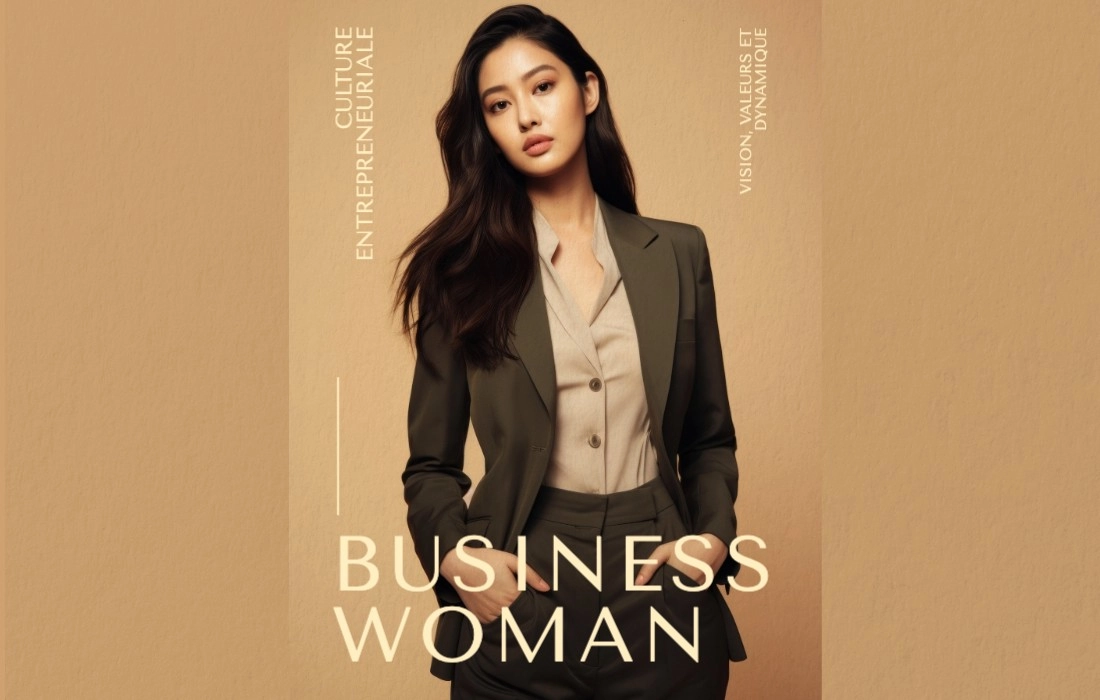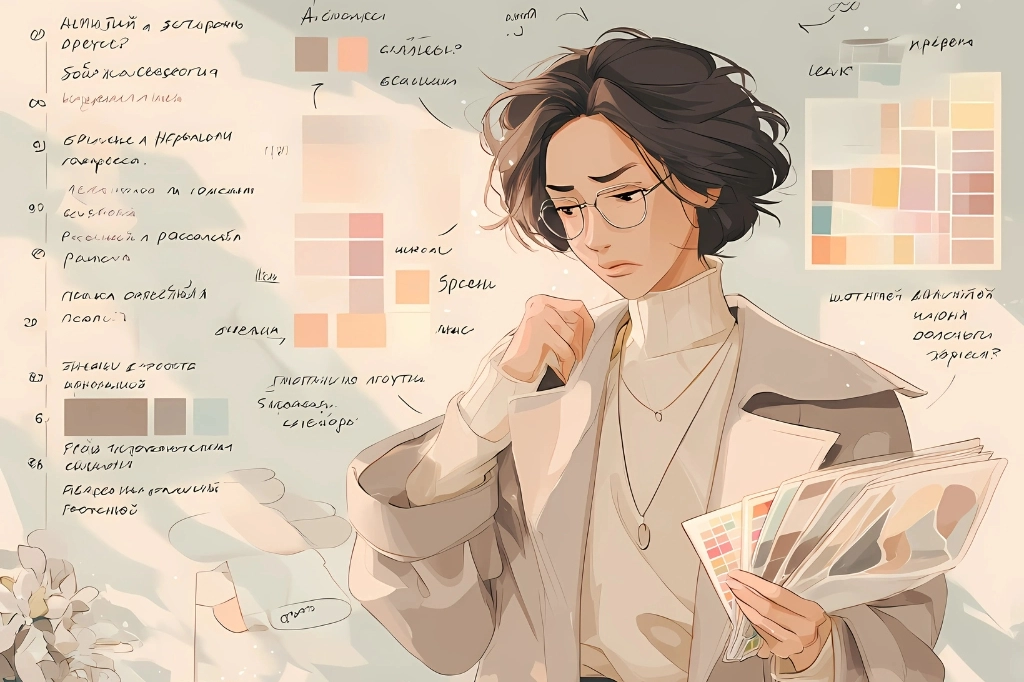L’initiative OBOR (One Belt, One Road) ou « Nouvelles Routes de la Soie » constitue le projet géoéconomique le plus ambitieux du XXIe siècle. Ce programme chinois vise à relier l’Eurasie, l’Afrique et l’Océanie autour de deux axes majeurs : terrestre et maritime.
Entre promesses de développement et craintes de domination économique, cette initiative redessine les équilibres mondiaux et place l’Afrique au cœur des enjeux stratégiques.
Retour aux sources historiques
L’ancienne Route de la Soie : premiers échanges mondialisés
Il y a 2000 ans, le monde connaissait déjà une forme de mondialisation. La curiosité réciproque entre l’Empire chinois et l’Empire romain a donné naissance à des échanges commerciaux d’envergure : étoffes, pierres précieuses, épices, armes transitaient le long de ce qui deviendra la légendaire « Route de la Soie ».
Ces échanges se sont maintenus jusqu’au XVe siècle, quand les guerres répétées entre Byzance et l’Empire Ottoman ont rendu ces vastes territoires trop dangereux à traverser.
Renaissance moderne d’un concept millénaire
En 2013, le président chinois Xi Jinping évoque pour la première fois le rêve de ressusciter ce corridor commercial sous le nom de Yidai yilu (« une ceinture, une route »), plus connu sous l’acronyme OBOR. Autrement dit : One Belt, One Road : les nouvelles routes de la soie!
En mai 2017, lors du sommet de Pékin, Xi Jinping présente les grandes lignes de ce projet titanesque. Bien qu’invoquant l’histoire millénaire et « l’esprit de la Route de la Soie » sous les bannières de la « paix » et de la « coopération », personne n’oublie que dans l’Empire du Milieu aussi, business is business.
Architecture du projet OBOR
One Belt : la nouvelle route terrestre
L’objectif consiste à relier rapidement la Chine à l’Europe via deux axes principaux :
Réseau ferroviaire : Une ligne partant du centre de la Chine traverse le Kazakhstan, la Russie, la Pologne, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. L’essentiel des rails existe déjà, particulièrement en Europe occidentale, et attend d’être connecté aux nouvelles lignes.
Le premier voyage de train de marchandises reliant la Chine à la Grande-Bretagne a eu lieu en janvier 2017. Ce train-fret a parcouru 12 000 km en 18 jours, prouvant la viabilité économique : moins cher que l’avion, plus rapide que le bateau.
Réseau routier : Un réseau routier gigantesque complète le dispositif ferroviaire, intégrant la masse continentale eurasienne dans une zone économique unifiée.
One Road : la route maritime stratégique
Cette voie maritime relie les pays émergents d’Asie du Sud-Est et du Sud jusqu’à l’Afrique et l’Amérique du Sud. Partant de l’Europe (France, Grèce, Pays-Bas), elle parcourt la Méditerranée, le canal de Suez, la mer Rouge, l’océan Indien jusqu’au Sri Lanka, descend vers Singapour puis remonte vers Shanghai.
Infrastructure portuaire mondiale
L’acquisition et la construction d’installations portuaires s’étendent à travers :
- Australie, Malaisie, Indonésie, Bangladesh
- Sri Lanka, Myanmar, Pakistan
- Kenya, Tanzanie, Oman, Djibouti
Ces ports se connectent au Pirée (Grèce), le plus grand port grec acheté par le groupe chinois COSCO, offrant un accès direct aux marchés européens.
Dimensions économiques du projet
Chiffres colossaux
Ce projet pharaonique représente plus de 1000 milliards de dollars d’investissements. Il pourrait unir 68 pays, environ 65% de la population mondiale, et son envergure économique dépassera potentiellement les deux tiers du PIB mondial.
Cinq domaines de coopération
L’initiative encourage officiellement :
- Coordination des politiques de développement
- Construction d’infrastructures et réseaux de services publics
- Renforcement des liens commerciaux et d’investissement
- Développement de la coopération financière
- Développement des échanges sociaux et culturels
Motivations chinoises profondes
Transformation du modèle économique
Après 30 ans de réception d’investissements directs étrangers, la Chine devient un investisseur majeur à l’étranger. Cette politique « Going Out » lancée fin des années 1990 vise plusieurs objectifs :
- Acquisition de ressources naturelles
- Pénétration de nouveaux marchés
- Promotion des marques chinoises
- Acquisition de technologies étrangères
Défis démographiques internes
La politique de l’enfant unique a provoqué un vieillissement rapide de la population. La population active diminue, entraînant une hausse des salaires et une réduction de la productivité.
Comparaison révélatrice : Le salaire moyen d’un ouvrier éthiopien à Hawassa s’élève à 50 dollars US, contre 300 dollars minimum pour un ouvrier chinois du Guangdong.
Cette réalité pousse la Chine à transférer ses activités de production intensive vers d’autres pays et à se concentrer sur des industries à plus forte valeur ajoutée.
Ambitions géopolitiques
Ne faisant pas partie du G7, l’OBOR donnerait à la Chine un poids régional considérable. Face au ralentissement du PIB, Pékin mise sur ces nouveaux échanges commerciaux pour stimuler sa croissance et canaliser sa surproduction.
L’initiative vise également à renforcer l’utilisation du yuan comme monnaie de réserve internationale.
Réactions contrastées dans le monde
Enthousiasme asiatique
Partisans enthousiastes :
- Pakistan et Indonésie : accueil très favorable
- Malaisie : délégation de 162 membres à Pékin en 2015
- Sri Lanka et pays d’Asie centrale : forte adhésion
- Russie : intérêt marqué pour le financement
Sceptiques et opposants :
- Vietnam : doutes sérieux sur l’initiative
- Inde : désapprobation franche et boycott actif
Méfiance occidentale
Les réactions européennes restent mitigées. Si les milieux d’affaires montrent de l’intérêt, les stratèges demeurent prudents. Donald Trump n’a pas participé au sommet de Pékin, et hormis l’Italien Paolo Gentiloni, aucun dirigeant du G7 n’était présent.
De nombreux pays européens (Allemagne, Hongrie, Estonie) craignent une perte d’influence en Asie centrale et refusent de s’associer aux communiqués chinois, inquiets de l’absence de transparence des marchés publics et des normes environnementales.
Riposte indo-japonaise
En réponse à l’OBOR, l’Inde s’unit au Japon pour créer un « corridor de la liberté ». Ils espèrent contrebalancer l’influence chinoise par des projets d’infrastructure en Asie du Sud-Est, au Sri Lanka, en Iran et en Afrique.
L’Afrique au cœur de la stratégie
Liens historiques renouvelés
Les relations sino-africaines remontent au XIVe siècle, quand la flotte chinoise fréquentait la côte orientale du continent. Cette histoire explique peut-être pourquoi la Chine fait du Kenya le pôle de son initiative africaine.
Projets structurants
Kenya : Les voies ferroviaires financées par la Chine relieront le Kenya et ses ports (notamment Mombasa) aux pays voisins enclavés : Burundi, Rwanda, Sud-Soudan, Ouganda.
Tanzanie : Emprunt de 7,6 milliards de dollars à la China Exim Bank en 2016 pour construire une ligne ferroviaire reliant la Tanzanie à l’Ouganda, au Rwanda, au Burundi et à la République démocratique du Congo.
Partenariats bilatéraux
La Chine a développé des relations avec l’Afrique du Sud, l’Éthiopie, Maurice, le Maroc, le Nigeria, les Seychelles, la Tunisie et la Zambie, accompagnées de traités bilatéraux d’investissement.
Promesses de développement
La China EXIM Bank a signé en 2016 un programme d’1 milliard de dollars pour construire parcs industriels et zones économiques spéciales en Afrique (transformation de produits de base, industries légères).
L’ancien économiste en chef de la Banque mondiale, Justin Lin, prédit que les nouvelles routes de la soie pourraient devenir « one belt, one road, one continent ».
Défis et risques du projet
Obstacles financiers
Certains pays partenaires présentent une faible solvabilité et pourraient ne pas rembourser leurs dettes. L’instabilité du Moyen-Orient et les oppositions locales (Sri Lanka, Myanmar) compliquent la mise en œuvre.
Surestimation des capacités
Selon Jonathan Hillman du Center for Strategic and International Studies, la Chine surestime peut-être ses capacités et pourrait financer des projets non rentables.
Endettement problématique
L’Inde critique ouvertement l’OBOR, lui reprochant de créer un « fardeau de dette insoutenable » et de menacer la souveraineté des pays participants.
Opportunités pour l’Afrique
Concurrence bénéfique
L’intérêt chinois pour l’Afrique attire l’attention d’autres puissances mondiales. L’axe indo-japonais et d’autres acteurs s’intéressent désormais aux promesses de développement du continent.
Potentiel démographique
Le potentiel inexploité d’économies africaines moins développées, avec une population jeune dynamique, séduit de nombreux investisseurs internationaux.
Infrastructure critique
Les besoins africains en infrastructures de transport, d’énergie et de communication offrent des opportunités considérables de développement économique.
Enjeux pour les pays maghrébins et africains
Opportunités stratégiques
Pour la Tunisie et le Maghreb :
- Positionnement géographique privilégié sur la route maritime
- Potentiel de hub logistique méditerranéen
- Accès facilité aux marchés européens et asiatiques
Pour l’Afrique subsaharienne :
- Développement des infrastructures critiques
- Création d’emplois et transfert de technologies
- Intégration régionale renforcée
Précautions nécessaires
Vigilance économique :
- Négociation équitable des conditions d’endettement
- Transparence des marchés publics
- Protection de la souveraineté économique
Diversification des partenaires :
- Éviter la dépendance exclusive à la Chine
- Maintenir des relations équilibrées avec d’autres puissances
- Développer les capacités de négociation locales
Perspective d’avenir
Incertitudes persistantes
Quatre ans après son lancement, il reste impossible de déterminer si l’OBOR sera couronné de succès ou promis à l’échec. L’ampleur du projet et sa complexité géopolitique rendent les prédictions hasardeuses.
Vigilance recommandée
De nombreux pays recommandent plus de vigilance face à l’évolution de l’OBOR. Les questions de transparence, de soutenabilité financière et de respect de la souveraineté restent centrales.
L’Afrique, potentiel grand gagnant
Paradoxalement, le continent africain pourrait être le grand bénéficiaire de cette compétition entre puissances. La concurrence sino-occidentale pour l’influence africaine pourrait accélérer le développement du continent.
Conclusion : navigation prudente dans les nouvelles routes de la soie
Les Nouvelles Routes de la Soie représentent une initiative d’une ampleur sans précédent qui redessine la géographie économique mondiale. Pour les pays africains et maghrébins, ce projet offre des opportunités considérables de développement, mais nécessite une approche prudente et stratégique.
L’enjeu consiste à tirer parti des investissements chinois tout en préservant la souveraineté économique et en diversifiant les partenariats. La compétition entre puissances pour l’influence africaine peut bénéficier au continent, à condition que les dirigeants africains négocient habilement ces nouvelles dynamiques géopolitiques.
Le « rêve chinois » de Xi Jinping pourrait bien transformer le rêve africain en réalité, mais seulement si les pays du continent savent naviguer avec sagesse dans ces nouvelles routes de la géopolitique mondiale.
Date de première publication: 30 octobre 2017
- Les Bienfaits Incontournables des Dattes pour la Santé
- La méthode KonMari : Qu’est-ce que c’est?
- Adénocarcinome canalaire infiltrant : le cancer du sein le plus fréquent au Maghreb
- Hannibal Barca : Leçons de leadership
- 8 Pensées Apaisantes pour Une Nuit Sereine
N’oubliez pas de nous suivre et de vous abonner à notre contenu
Originally posted 2017-09-05 11:31:58.