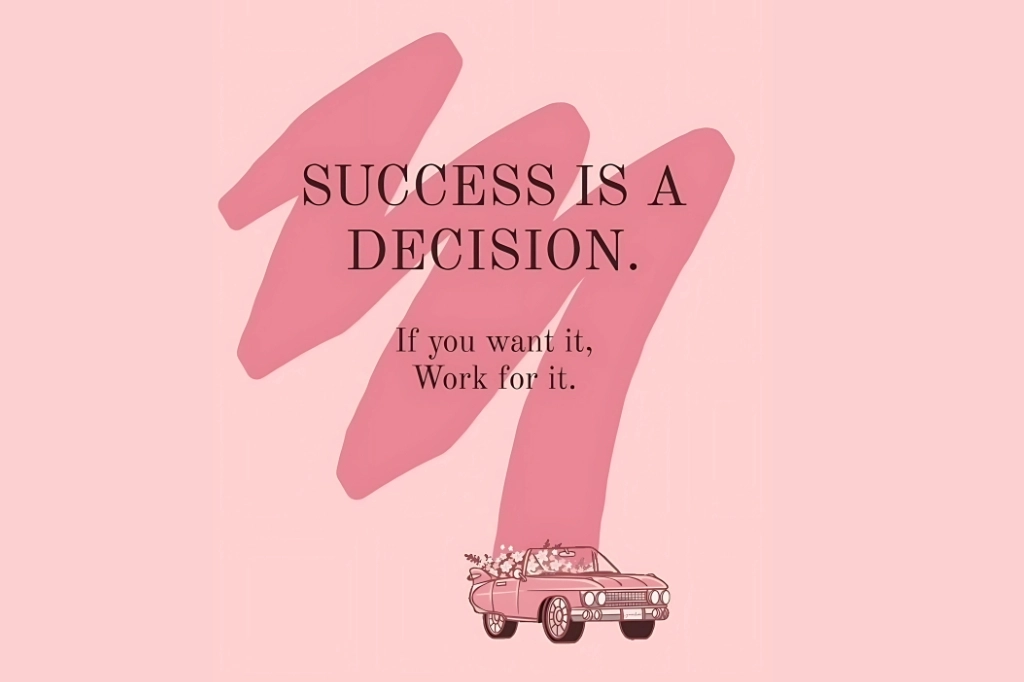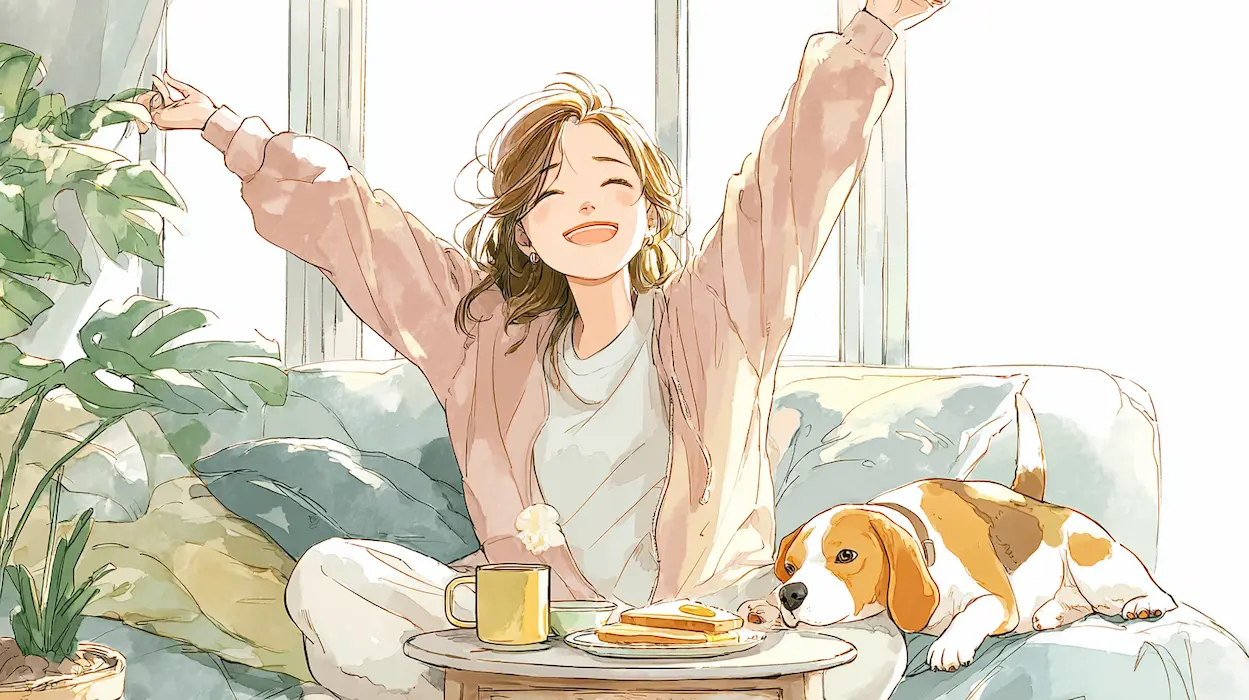Homo homini lupus est, une locution latine de Plaute signifiant « l’homme est un loup pour l’homme ». En ces temps troublés, il serait légitime de croire que cette phrase reste d’actualité. Cependant, ceux qui considèrent que les êtres humains ne sont que des manipulateurs égoïstes auront du mal à concevoir la grandeur d’âme de celles et ceux qui nous prouvent combien nous sommes tous perfectibles. Il y a du bon en chacun de nous.
L’année 2019 commence bien et commence fort. L’ambiance globale demeure tendue. Notre quotidien n’a jamais été aussi morose : chute vertigineuse de notre monnaie nationale, détérioration sans précédent de notre pouvoir d’achat, nivellement par le bas. Par ailleurs, les grèves récurrentes des enseignants de l’école publique s’accompagnent d’une incompréhension totale des parents dont les enfants sont pris en otage.
Avouons que le « leadership par l’exemple » laisse à désirer dans ce pays. Bon nombre d’augustes responsables se valent bien et valent bien peu. Ce constat est triste et les mots pour le dire sont sévères. Pourtant, des solutions concrètes et uniques existent. Ces solutions se trouvent en nous. Chacun d’entre nous.
Il y a deux réalités qui s’affrontent aujourd’hui. La première nous est imposée par des personnes motivées par l’amour du pouvoir. La deuxième nous est offerte par les personnes motivées par le pouvoir de l’amour.
L’hypothèse de la vitre brisée : un environnement qui façonne nos comportements
En huit ans, cette hypothèse a pris forme sous nos yeux et façonne depuis notre quotidien. La théorie naît dans les années 1930 aux États-Unis et se développe durant les années 80-90. Elle établit un rapport de causalité entre les détériorations de l’espace public et un délabrement plus général des situations humaines qui en découlent.
Si on fait vivre une communauté humaine dans un espace délabré, le comportement général tend vers le désordre. Or, s’il y a bien quelque chose qui caractérise notre espace public ces dernières années, c’est bien le délabrement visible : amoncellement des déchets, grande insalubrité environnementale, absence notoire des forces de l’ordre.
Bien que la responsabilité municipale soit indéniable, il faudrait aussi se pencher sur nos responsabilités individuelles. Demandons-nous constamment : « que puis-je faire pour améliorer les choses ? »
Par expérience, il suffit d’initier une action positive pour inspirer son entourage à en faire de même. Une dynamique se met très souvent instantanément en place. N’attendez pas le passage des agents municipaux pour nettoyer votre environnement, ramasser les petits bouts de papiers et autres emballages qui agrémentent nos rues et ruelles.
J’attire particulièrement l’attention de celles qui nettoient les cours des maisons à grand renfort d’eau. Je ne parlerai pas de ce mode de nettoyage très peu écoresponsable, surtout dans un pays menacé par un stress hydrique croissant. Cependant, je soulignerai l’absence d’hygiène qui accompagne les eaux sales, souvent stagnantes qui finissent dans les rues et devant les clôtures des maisons.
Ce geste pardonnable du temps de nos aïeules n’a aucun sens de nos jours. Pourtant on le reproduit, sans même se rendre compte que la moindre des choses serait de ramasser les déchets qui accompagnent ces eaux sensées purifier nos intérieurs.
En fait, il suffit de commencer petit. Disons-nous que la somme de petites actions finira par induire les changements qu’on souhaiterait voir se produire.
Générosité, bonté et gratitude : les piliers de la solidarité
Les Tunisiens sont généreux. C’est indéniable et c’est d’ailleurs leur plus belle qualité. Pourtant, la générosité à elle seule ne suffit pas. Nous partageons nos ressources, nous donnons à manger, nous soutenons financièrement une personne dans le besoin. Mais nous le faisons avec une certaine réserve émotionnelle.
On donne de son argent sans problème, mais on ne donne pas suffisamment de soi. On ne donne pas de son temps, on ne donne pas son sourire, son affection, sa chaleur humaine, sa courtoisie, son amabilité.
Pour y remédier, il faudrait non seulement multiplier les bonnes actions mais aussi pratiquer la gratitude. Cette dernière est, rappelons-le, l’une des clés du bonheur, même lorsqu’on évolue dans des contextes hostiles. On cesse de se comparer aux autres, on réduit son agressivité parce qu’on se sent chanceux, on développe son estime de soi et son empathie.
S’il fallait commencer quelque part, c’est par la gratitude qu’il faudrait le faire.
L’empathie, un trait inné à encourager pour renforcer la solidarité
Des découvertes scientifiques ont prouvé que l’être humain est une espèce empathique. L’équipe du professeur en physiologie humaine Giacomo Rizzolatti révèle en 1996 à Parme que les « neurones miroirs » s’activent de la même manière lorsque les personnes ressentent une émotion et lorsqu’elles voient quelqu’un la ressentir.
Ainsi, nous pouvons percevoir les émotions des autres comme si elles étaient les nôtres. Les chercheurs en psychologie, Felix Warneken et Michael Tomasello ont étudié la gentillesse spontanée des enfants de 18 mois. Ils ont observé que ceux-ci pouvaient interrompre leurs jeux pour aider spontanément un adulte qui leur demanderait, par exemple, de déplacer quelque chose.
L’imagerie à résonance magnétique nous révèle que les gestes de coopération activent, dans le cerveau, les mêmes zones de plaisir que lorsque nous mangeons une gourmandise. En revanche, la compétition stimule celles du dégoût.
Selon une étude américaine, les personnes ayant une activité bénévole ont de meilleurs scores dans l’évaluation du sentiment de bonheur, de l’estime de soi et de la qualité de vie que la moyenne. Il semblerait aussi que ces personnes, généralement moins dépressives, soient moins touchées par la maladie d’Alzheimer, vivent plus longtemps et sont en meilleure santé.
Donc soyez bon, cela vous fait du bien !
La solidarité au cœur de la réponse collective
Il suffit de se remémorer cet extraordinaire élan de solidarité au lendemain de la chute du régime de Ben Ali en Tunisie. Pensons aux caravanes qui sillonnent régulièrement le territoire pour aller dans les régions défavorisées, ou encore au soutien apporté aux réfugiés libyens pendant la guerre.
L’exploit réalisé par l’association Maram Solidarité qui réussit à collecter en 2017 la somme de 1.257.882 DT pour la construction d’une unité spéciale au sein du centre de greffe de la moelle osseuse de Tunis pour les enfants cancéreux illustre parfaitement cette générosité. Plus récemment, l’aide portée par les Tunisiens aux habitants des régions sinistrées par les dernières inondations, mais aussi l’inauguration du centre culturel des arts et métiers de Jbel Semmama par la fondation Rambourg dans le gouvernorat du Kasserine témoignent de cet esprit de solidarité.
Les exemples sont très nombreux et émanent aussi bien d’initiatives individuelles que d’actions organisées au sein d’associations, de collectifs ou de fondations. Les réseaux d’entraides foisonnent non seulement chez nous, mais également partout ailleurs dans le monde (aux USA on en dénombre plus de cinq cents mille).
L’être humain est enclin à collaborer avec les autres, lorsque l’occasion lui en est donnée, pour le plaisir de contribuer à l’intérêt général.
L’empathie et la solidarité à l’ère numérique
Sur le web, les sites de dons prolifèrent et les gens offrent à de parfaits inconnus des objets dont ils ne se servent plus. Les initiatives prônant l’entraide et la bienveillance se multiplient. Ainsi dix-sept pays dans le monde organisent chaque année la journée de la gentillesse. Sans oublier ces fameuses séances de free hugs ou encore toutes les séquences intitulées random acts of kindness, que l’on pourrait traduire par des « actes de bonté aléatoires ».
Les modèles de coopération se multiplient en ligne. Des milliers d’internautes partagent leurs connaissances sur Wikipédia. Des professeurs apportent un soutien scolaire aux plus jeunes, sans se faire rémunérer. Ils créent des pages, exposent leurs cours, énoncent des exercices et fournissent leurs corrigés. Les lycéens préparant leurs examens du baccalauréat ne peuvent qu’en témoigner.
Des études ont montré que les interactions en ligne, loin de créer un repli sur soi, encouragent au contraire une plus grande sociabilité dans la vie de tous les jours. La preuve nous en est donnée par les millenials, la génération du millénaire, celle qui se compose de ces deux milliards de jeunes ayant grandi avec internet.
En effet, cette génération également surnommée la « génération G » et contrairement à la génération X (personnes nées dans les années 60 et 70) et à la génération Y (nées dans les années 80) est constituée d’individus consommateurs et citoyens.
Pour eux, la générosité, l’échange, l’attention portée aux autres représentent des éléments de satisfaction personnelle. La simple consommation ne constitue pas pour eux une valeur sociale, mais un comportement responsable et citoyen.
La culture du web, élaborée par des personnes qui donnent, échangent et collaborent, les a habitués aux notions de partage et de générosité. Une des conséquences directes de ce phénomène est l’habitude de la gratuité. Cela les amène à privilégier le troc et le recyclage à l’achat.
Évoluant dans un contexte de crise, la génération G est attentive aux prix, à la recherche de services rapides et préfère les marques socialement responsables. D’ailleurs, l’engagement de celles-ci dans une cause constitue un facteur déclencheur d’achat : pour des produits concurrents à prix équivalents, on privilégie la marque engagée.
Agir maintenant pour cultiver la solidarité et l’empathie
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un concours de circonstances uniques. Mais cette situation n’a rien d’exceptionnel. Toutes les générations humaines ont dû se confronter un jour ou l’autre à une problématique similaire : comment vit-on dans des conditions hostiles ?
Vous imaginez si nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avaient attendu que les gros carnivores se lassent du goût de la chair humaine pour assurer leur survie, au lieu de faire preuve d’ingéniosité pour s’adapter à la situation et surmonter les difficultés ?
Vous voyez, il y a toujours moyen de s’en sortir. Il suffit de ne pas être fervent partisan de la fatalité et de décider de prendre les choses en main et d’agir.
- La méthode KonMari : Qu’est-ce que c’est?
- Adénocarcinome canalaire infiltrant : le cancer du sein le plus fréquent au Maghreb
- Hannibal Barca : Leçons de leadership
- 8 Pensées Apaisantes pour Une Nuit Sereine
- Types cancer du sein : comprendre la diversité pour mieux combattre
Originally posted 2019-01-04 12:41:00.